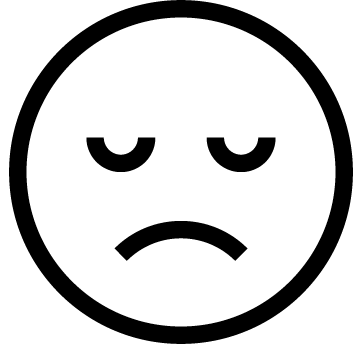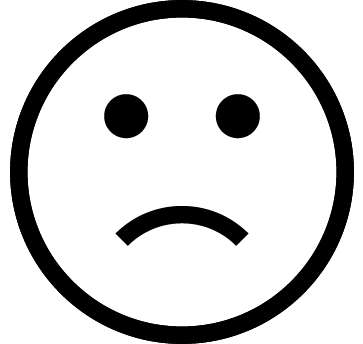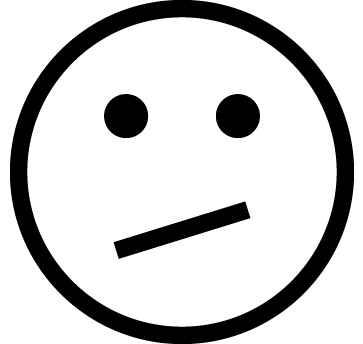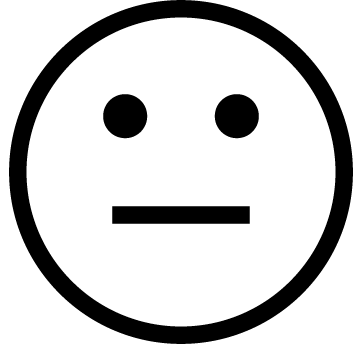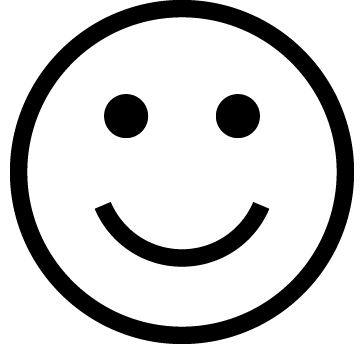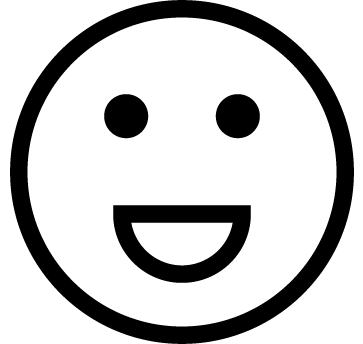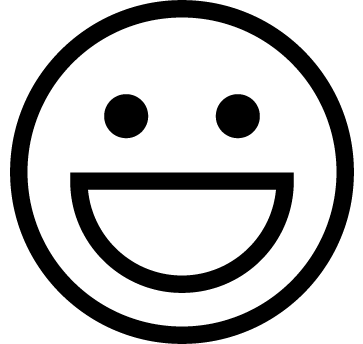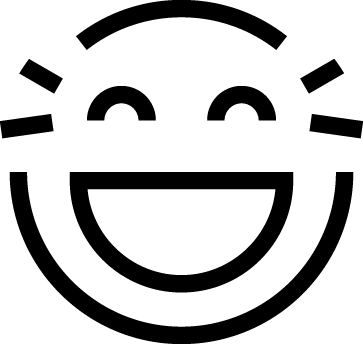Les Québécois étirent l'élastique!
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Alcool au volant
Les Québécois étirent l'élastique
Québec, le 20 novembre 2008.- À l'aube des célébrations et réceptions de Noël, il est inquiétant d'apprendre que 40 % des Québécois avouent conduire leur voiture en sachant bien que leur taux d'alcoolémie dépasse la limite permise.
La récente enquête de l'IRB (www.indicedebonheur.com) permet d'apprendre que 25 % des répondants le font rarement alors que 15 % le font régulièrement. Pour Pierre Côté, fondateur de l'IRB, il est clair que ces chiffres sont conservateurs et que, dans la réalité, les proportions risquent fort d'être plus élevées, la totale honnêteté des répondants pour un tel sujet pouvant être «questionnable».
La lente évolution des mentalités
L'enquête de l'IRB nous permet de réaliser qu'il y a de l'amélioration, mais qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Ainsi, ce sont les jeunes de moins de 35 ans qui se montrent les plus responsables et les plus sensibilisés, mais ils sont tout de même 32 % à avouer qu'il leur arrive de conduire leur véhicule en sachant bien que leur taux d'alcoolémie dépasse la limite permise. Cette proportion grimpe à 46 % pour les personnes de 45 ans et plus.
«Le travail de sensibilisation qui a commencé il y a plusieurs années donne des résultats, mais les progrès sont lents. L'alcool est au cur de la vie sociale et sa consommation est banalisée, ce qui rend la modification des comportements encore plus difficile. Adopter un nouveau comportement ne prend souvent que quelques minutes alors qu'en changer un peut demander toute une vie» explique Pierre Côté.
Les clientèles à risque
Contrairement à une perception répandue, l'enquête de l'IRB nous apprend que la conduite de son véhicule, en sachant que son taux d'alcoolémie dépasse la limite permise, augmente avec le niveau du revenu et de scolarité des répondants.
Conduite de son véhicule en sachant que son taux d'alcoolémie dépasse la limite en fonction des revenus et de la scolarité des répondants
Secondaire 5 32 % 40 000 $ et moins 36 %
Collégial 34 % 40 à 60 000 $ 45 %
Univ. 1er cycle 41 % 60 à 80 000 $ 50 %
Univ. 2e cycle 54 % 80 000 $ et plus 55 %
« Les personnes avec des revenus ainsi qu'un niveau de scolarité plus élevés sont, par leur travail ou leurs activités, confrontées plus régulièrement à des occasions de conduire en ayant préalablement consommé, mais cela ne les excuse en aucun cas de leur comportement» affirme Pierre Côté.
Outre l'âge, la scolarité et les revenus, le sexe représente l'autre facteur aggravant : les hommes sont 45 % à avouer conduire leur véhicule en sachant que leur taux d'alcoolémie est supérieur à la norme, alors que cette proportion descend à 34 % chez les femmes.
Travailler sur la machine plutôt que sur l'humain
L'enquête de l'IRB suggère implicitement de travailler sur la machine plutôt que sur l'humain pour résoudre le problème de l'alcool au volant, mais les répondants affichent de la réticence face à cette solution.
Ainsi, un peu moins des deux tiers (62 %) serait d'accord pour munir les voitures d'un système qui empêcherait le moteur de démarrer si le conducteur affiche un taux d'alcoolémie supérieur à la limite.
Cet accord fond à 24 % si on appliquait ce système en fonction de la moindre trace d'alcool dans le sang du conducteur (limite zéro, tolérance zéro).
« Les Québécois ne sont pas vraiment prêts à éliminer complètement le problème de l'alcool au volant et souhaitent se laisser une certaine marge de manuvre. Une marge de manuvre qui fait appel à leur bon jugement, à leur discernement et qui n'entrave pas trop leurs habitudes et leur comportement. Doit-on leur faire confiance? Les statistiques ne leur donnent pas vraiment raison » conclut Pierre Côté.
Les personnes qui affichent les plus hauts revenus et le plus haut niveau de scolarité sont les plus nombreuses à manifester leur désaccord face à ce principe.
Le bonheur loge à l'enseigne de la sobriété au volant
Le bonheur est toujours raisonnable et, encore une fois, s'affiche résolument du côté des personnes qui n'utilisent jamais leur voiture en sachant que leur taux d'alcoolémie est supérieur à la limite permise. Leur IRB est de 5 points supérieurs à celui des personnes qui ont le comportement contraire (78,20 vs 73,60).
Pour tout savoir sur les résultats de cette enquête de l'IRB, consultez le site www.indicedebonheur.com
(Veillez, dans la mesure du possible, mentionner la référence et le site internet dans vos reportages).
Cette enquête a été réalisée entre le 27 août et le 27 octobre 2008 auprès de 1 092 répondants, ce qui lui confère une marge d'erreur de 3,7 %.
- 30 -
L'IRB (www.indicedebonheur.com) s'impose de plus en plus comme un véritable observatoire social qui explore et détermine les caractéristiques, attitudes, attributs et comportements qui favorisent l'amélioration du bonheur des collectivités et de ceux et celles qui la composent. L'IRB souhaite fournir à ses lecteurs, aux médias et aux décideurs une information toujours de grande qualité qui contribuera à faire du bonheur une variable qui compte et qui complétera les variables économiques et financières existantes.
- 30 -
Source : Pierre Côté, IRB*
*L'IRB est une marque déposée appartenant à Côté communication conseil
Information et entrevues :
Pierre Côté
418 524-7375
info@indicedebonheur.com